L’histoire de la Tunisie est faite de métissages, de circulations et de mémoires partagées. Au cœur de ce patrimoine humain se trouvent les Afro-Tunisiens, également appelés noirs tunisiens ou Afro-descendants en Tunisie. Présents depuis plus d’un millénaire, ces groupes ont contribué de manière déterminante à la formation de la société tunisienne.
Une présence afro-tunisienne ancienne
Les communautés afro-tunisiennes regroupent des descendants d’Africains subsahariens arrivés par les routes transsahariennes dès le Moyen Âge, des familles affranchies après l’abolition de l’esclavage en 1846 et des migrants volontaires ou réfugiés depuis la fin du XIXe siècle, notamment via la Tripolitaine.
Les implantations sont historiquement plus denses dans le sud du pays, à Gabès, Medenine, Kébili, Djerba et Zarzis, tout en étant présentes dans les grandes villes comme Tunis et Sfax. Des estimations situent ces populations autour de 10 à 15 pour cent de la population totale selon les sources.
Des racines historiques profondes et complexes
Traite transsaharienne et esclavage
Dès le VIIIe siècle, des caravanes relient l’Afrique subsaharienne au Maghreb. Des femmes et des hommes sont acheminés comme esclaves, domestiques ou travailleurs agricoles vers les oasis du Jérid et les grandes villes tunisiennes. L’abolition de 1846 constitue un tournant, sans effacer instantanément les hiérarchies sociales héritées.
Migrations volontaires et catégories administratives
De la fin du XIXe au milieu du XXe siècle, la Tunisie accueille des ouvriers et saisonniers dits soudanais, tripolitains ou fezzanis. L’administration coloniale emploie des catégories floues qui mélangent origine, couleur et statut. Un accord franco italien de 1914 présume sujets tunisiens les indigènes d’origine tripolitaine arrivés avant le 28 octobre 1912, ce qui influe sur les trajectoires d’identification et de naturalisation.
Impacts économiques
Une part notable de ces migrants travaille dans l’agriculture, les mines et les grands chantiers. Des archives signalent, dès les années 1890, des arrivées massives dites tripolitaines noires ainsi que des parcours d’affranchis installés à Médenine et Gabès.
Mémoire familiale et généalogie afro-tunisienne
Les archives d’état civil et la mémoire orale conservent des traces liées à l’esclavage et à l’affranchissement. On rencontre par exemple les mentions abd pour esclave et tiq pour affranchi, ainsi que des prénoms récurrents au sein des lignées. Dans de nombreux parcours, l’auto désignation tripolitaine a servi d’écran social pour éviter la stigmatisation associée à l’esclavage.
- Repérer les variantes d’un même nom dans registres et actes notariés.
- Documenter les changements de nom et les filiations par témoins.
- Recouper avec la presse locale et les recensements lorsqu’ils existent.
Les noms de famille des noirs tunisiens
Les patronymes sont des repères généalogiques majeurs et des traces des hiérarchies sociales. Certains noms renvoient explicitement à l’esclavage ou à l’affranchissement. D’autres marquent des relations de clientèle ou l’appartenance à des maisons notables.
Patronymes liés à l’esclavage et à l’affranchissement
- Atig ou Atiq dérivé de tiq qui signifie affranchi.
- Chouchan mentionné pour des lignées associées historiquement au statut servile.
- Ucif parfois orthographié Oucif, renvoyant au sens de serviteur selon les contextes.
Noms des familles propriétaires et effets de domination
Des patronymes tels que Al Abyadh ou Al Urimi sont cités dans les sources comme appartenant à des familles ayant possédé des esclaves, ce qui a laissé des marques durables dans les relations sociales et les désignations familiales.
Le projet d’homogénéisation et la refonte des noms
Après l’indépendance, l’État tunisien renforce la logique du nom de famille unique et mène des campagnes de révision des noms jugés stigmatisants ou étrangers. Entre 1959 et les années 1970, de nombreuses familles noires changent de patronyme pour se conformer au nouveau cadre. Dans certains cas, de nouveaux noms comme Shair, Hamrouni ou Zitouni sont adoptés, parfois en lien avec d’anciens réseaux de dépendance, ce qui brouille les filiations d’origine.
Conséquences pour la recherche généalogique
- Effacement partiel des lignées par rupture entre ancien et nouveau patronyme.
- Fardeau symbolique pour les familles ayant conservé des noms connotés servitude.
- Nécessité de cartographier les trajectoires de changement de nom pour reconstituer l’ascendance.
Un patrimoine culturel vivant
Le Stambali
Le Stambali est un rituel musical et spirituel d’ascendance ouest africaine, réélaboré en Tunisie. Il associe transe, chants et pratiques de guérison et fait désormais partie du patrimoine culturel tunisien.
Traditions et savoir faire
Musiques, artisanats et sociabilités confrériques témoignent d’une présence ancienne et structurante pour l’histoire sociale de la Tunisie.
Identité, visibilité contemporaine et défis
Longtemps invisibilisés dans le récit national, les noirs tunisiens gagnent en visibilité depuis 2011. Une loi contre la discrimination raciale est adoptée en 2018. Des défis persistent, dont un flou identitaire hérité des catégorisations coloniales et la nécessité d’articuler deux trajectoires souvent amalgamées, descendants d’esclaves et migrants volontaires.
La question des noms de famille illustre l’entrelacement de l’histoire, de la bureaucratie et de l’identité dans la vie des familles noires tunisiennes.
La généalogie comme outil de réhabilitation
La généalogie afro tunisienne permet de retracer des lignées effacées, de comprendre les trajectoires issues de l’esclavage ou des migrations et de valoriser des mémoires orales et écrites longtemps marginalisées. Elle aide aussi à identifier des flux comme Tripolitaine vers Tunisie et à documenter les changements de patronymes.
Personnalités noires tunisiennes célèbres
Plusieurs figures afro-tunisiennes ont marqué la vie politique, culturelle et religieuse du pays :
Militants et politiques
- Slim Marzouk – militant politique indépendantiste dans les années 1960-70.
- Saadia Mosbah – militante antiraciste, présidente de l’association Mnemty.
- Maha Abdelhamid – géographe et militante antiraciste.
- Bechir Chammam – premier député noir de la Tunisie postrévolutionnaire.
- Jamila Debbech Ksiksi – députée, figure politique importante, seule femme noire de l’Assemblée lors de son mandat.
- Houda Mzioudet – journaliste et militante antiraciste.
Artistes et musiciens
- Slah Mosbah – chanteur et compositeur reconnu, symbole de la fierté afro-tunisienne.
- Sabry Mosbah – chanteur et compositeur contemporain, fils de Slah Mosbah.
- Abid Ghbonton – groupe de musiciens et danseurs originaires de Gosba (Médenine), gardiens des traditions musicales afro-tunisiennes.
Figures religieuses
- Sidi Fraj – saint soufi noir dont le mausolée à La Marsa est un lieu de mémoire spirituelle important.
Sportifs
- Hatem Trabelsi – footballeur international tunisien, latéral droit emblématique de la sélection nationale et ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de Manchester City.
Ces personnalités incarnent la diversité des contributions afro-tunisiennes à la société contemporaine, dans des domaines allant de la politique aux arts, en passant par la spiritualité et le militantisme.
Regards vers l’avenir
Les Afro Tunisiens, les noirs tunisiens et les Afro descendants en Tunisie constituent une composante essentielle de l’identité du pays. Leur histoire va des routes caravanières à la modernité politique. La généalogie, la culture et la mémoire sont des leviers pour inscrire pleinement cette présence dans le récit collectif national, tout en clarifiant les héritages patronymiques.


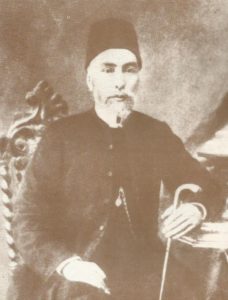



Soyez le premier a laisser un commentaire